Utilisez l’espace commentaire ci-dessous pour me raconter vos expériences ! Comment la biologie du comportement vous a-t-elle été présentée pendant vos études en sciences sociales ? De façon positive ? Négative ? Des anecdotes en particulier ?
Le temps de récolter vos retours je ne les affiche pas publiquement, mais ils le seront sûrement ensuite, donc écrivez comme si votre commentaire allait être publié (anonymisation si besoin, etc). Ou mentionnez explicitement que vous ne souhaitez pas qu’il le soit.
Vous pouvez également me contacter directement si vous préférez.

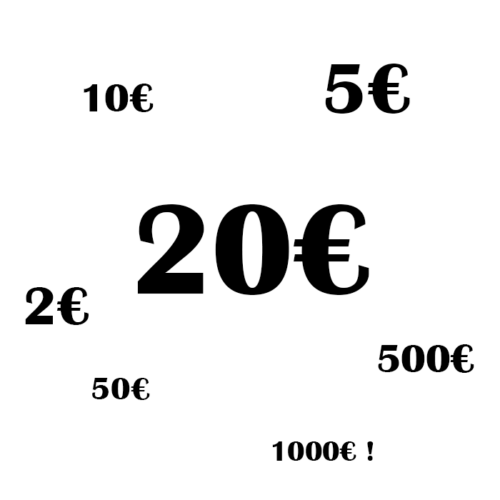
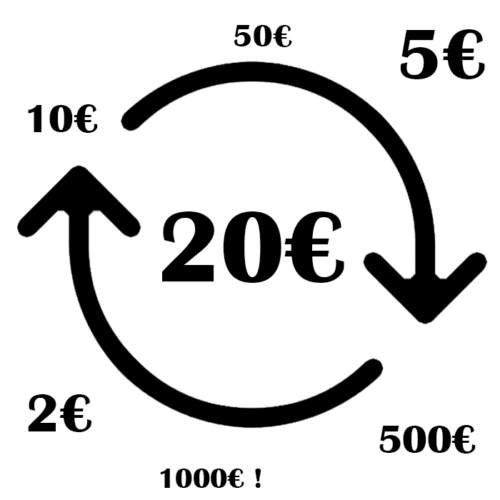
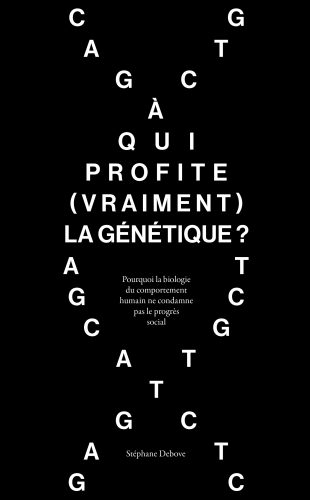
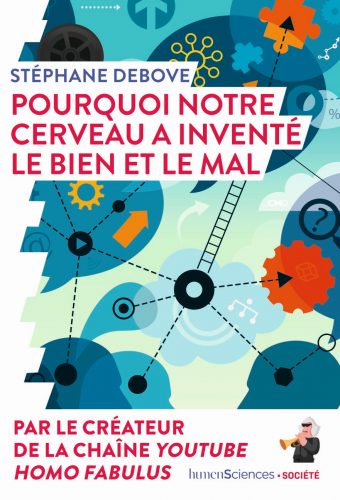
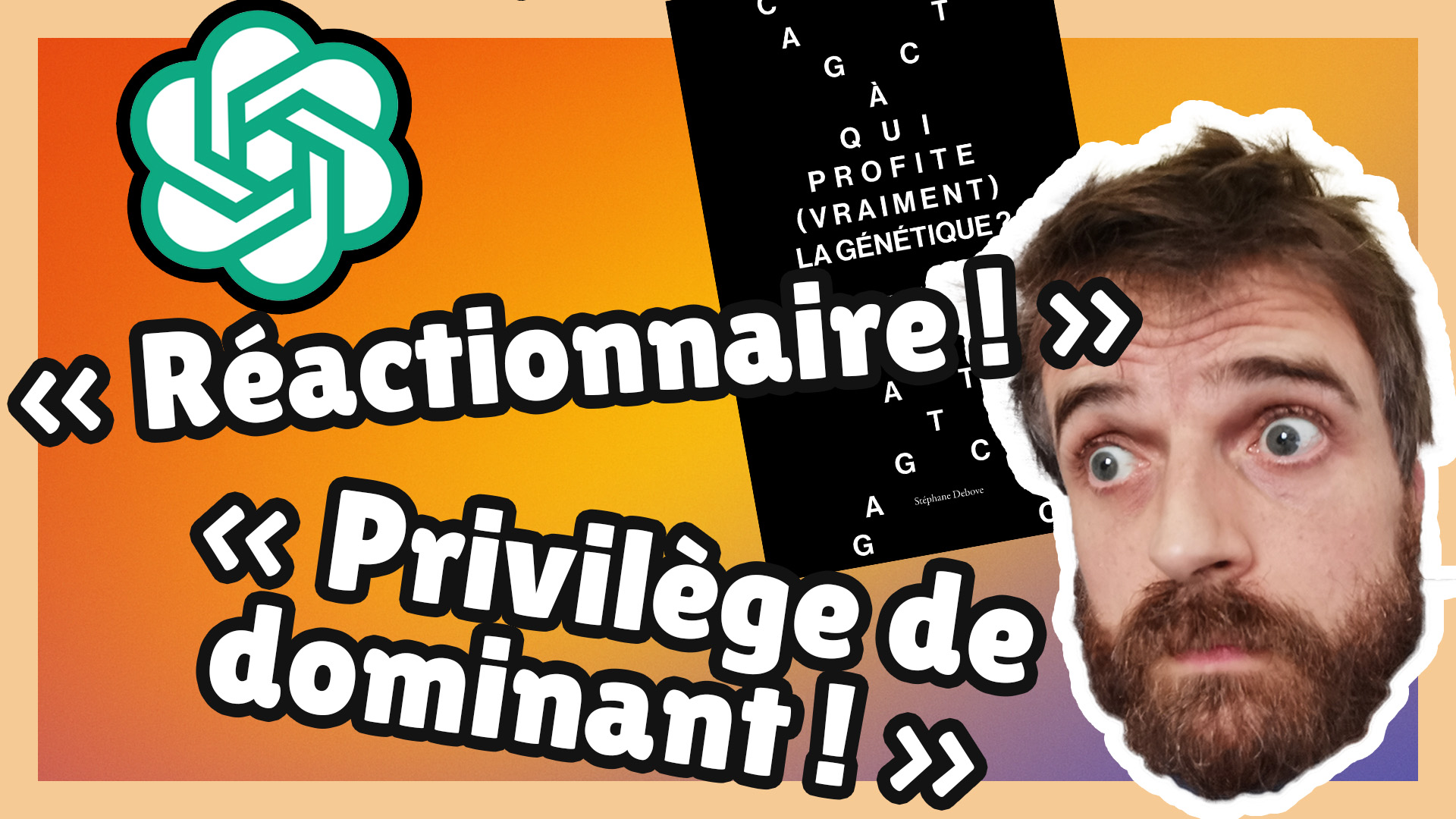

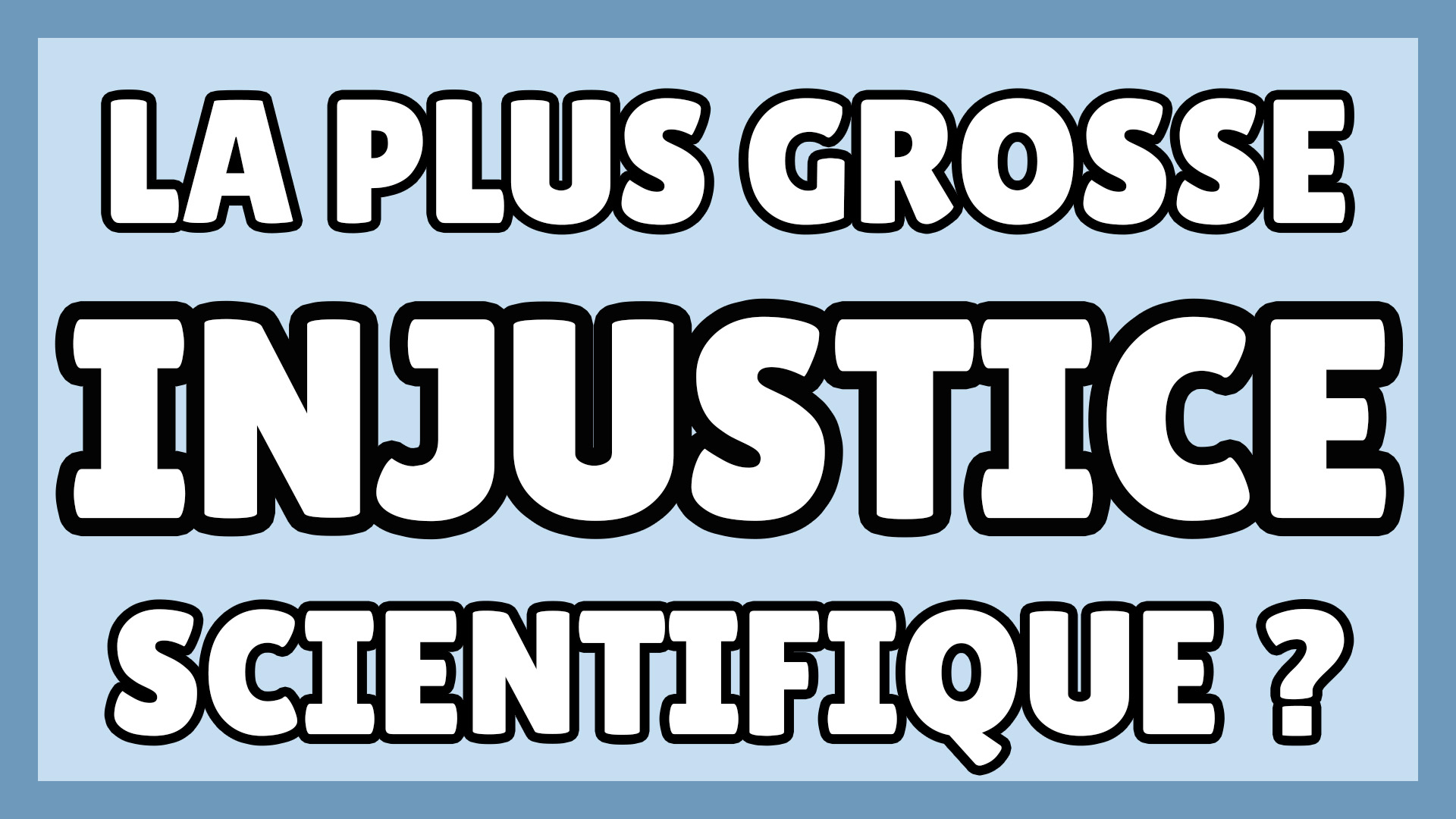
Répondre à MARTIN Annuler la réponse